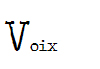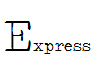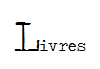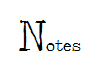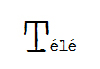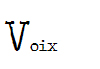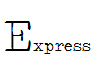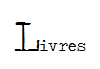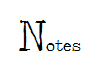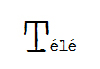|
 
- Gilles Verlant présente
- 1967 par Fabrice Drouelle et Frédéric Lecomte
- L'année de l'amour
Editeur :
Fetjaine
Date de parution : 16 mai 2007
 Le
livre Le
livre
1967 : L'année lumière et l'été de l'amour. Une
explosion multicolore et "multisonore" placée sous les délires du
psychédélisme. Une nouvelle génération d'enfants-fleurs aspire à une
libération des meurs, révolution libertaire et contestataire qui, aux
Etats-Unis, s'exprime à travers le pacifisme - guerre du Vietnam oblige -,
tandis qu'en Angleterre, la rébellion demeure essentiellement artistique :
Pop music, pop art, mode vestimentaires etc.
1967 est l'année de l'été de l'amour (Summer of love)
et du pouvoir des fleurs (Flower power), le passage entre la
génération beatnick et la génération hippie. L'année de l'amour libre
grâce à la pilule contraceptive. L'année du premier festival de pop music
à Monterey et celle de toutes les utopies, quand la jeunesse se persuade
qu'un artiste de rock peut changer le monde avec une guitare.
Musicalement, 1967 marque l'avènement de chefs-d'œuvre
absolus, à commencer par le Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band
des Beatles, mais aussi, entre autres, de Are You Experienced? de
Jimi Hendrix, ou du premier album du Pink Floyd.
Avant 1967, la jeunesse se prélassait luxueusement dans
l'univers des trente glorieuses. Après 167, elle proteste, conteste et
manifeste en masse. Mai 68 est en gestation. C'était hier, il y a tout
juste quarante ans. Ce livre abondamment illustré évoque la musique, les
événements et l'ambiance de cette année fabuleuse.
 Les
Auteurs Les
Auteurs
Fabrice Drouelle est le présentateur du journal
de 13 heures de France Inter. Il a produit en 1994 une série quotidienne
consacrée aux Beatles sur France Inter.
Frédéric Lecomte est journaliste (Télérama,
Guitare et claviers), réalisateur (M6, Canal+,...), conférencier,
historien et spécialiste du rock.
 Préface Préface
Je
ne vais pas vous faire le coup du "j'y étais, j'ai tout vu, tout vécu, je
m'en souviens comme si c'était hier" parce que ce serait un mensonge
éhonté, vu que je suis né en 1957… Pourtant, je revois clairement le jour
où mon papa a posé sur la platine familiale un 33 tours des Beatles à la
pochette bariolée, bourrée de détails rigolos (y compris une planche en
papier cartonné pour les gamins : j'avais immédiatement découpé la fausse
moustache et les galons pour me déguiser en Sgt. Pepper). Et puis la
musique nous faisait bien plaisir, à ma maman et moi (on ne disait pas
"kiffer" ni "s'éclater" à l'époque). Elle mettait du sourire dans la
maison, d'inexplicables bonnes vibrations. Quelques semaines plus tard,
j'avais vu les Beatles, en Mondiovision (et en noir et blanc) ; ils
chantaient All You Need Is Love. Ma maman m'avait traduit les paroles.
Quelques jours plus tard, comme j'arrêtais pas de la supplier, elle
m'avait acheté le 45 tours. J'aimais bien les Beatles. J'étais fils
unique, ils étaient comme des grands frères que j'aurais bien aimé avoir.
Après tout ils avaient quoi ? 25, 26 ans ?
J'avais 10 ans en 1967 et aucune idée de ce qui pouvait se passer à San
Francisco, même si huit ans plus tard je fis en sorte d'aller voir sur
place, avec mes potes, nos abonnements de bus Greyhound et nos sacs à dos.
Nous croisâmes sans doute des hippies qui avaient participé aux
légendaires Human Be-In et autres Love-In. Nous cherchâmes la maison bleue
adossé à la colline da la chanson de Maxime Leforestier. Nous vîmes
surtout des clochards pas du tout célestes, les yeux enfoncés dans les
orbites et le teint grisâtres. La ville était plutôt crade du côté de
Haight-Ashbury, au contraire de Berkeley, que nous avions adoré au point
d'y rester trois semaines, logés par un gars de notre âge qui trouvait
tout à fait normal d'héberger cinq ados boutonneux et boucanés au milieu
de son salon… Déjà, la nostalgie battait son plein, et nous n'étions qu'en
1975 : les affiches psychédéliques légendaires des concerts au Fillmore
étaient rééditées à tour de bras, ainsi que les comix underground de Crumb
et S. Clay Wilson. Nous avions ramené des tonnes de disques, achetés
d'occase, pour moins d'un dollar, chez Rasputin : des Jefferson Airplane,
des Quicksilver Messenger Service, des Charlatans… De quoi combler les
trous dans notre culture musicale, avec la cruelle impression d'avoir raté
quelque chose de miraculeux, un moment unique dans l'histoire de
l'humanité, où l'utopie avait pris le pas sur la raison, sans aucune
chance de réussite, bien sûr…
Ce miracle s'était produit en 1967, l'année de l'amour. Plus près de nous,
à Londres, d'autres musiciens, d'autres avant-gardistes tentaient de
trouver une autre voie, une autre conscience, en usant et abusant de
substances hallucinogènes. Ils croyaient, avec une naïveté qui force
aujourd'hui l'admiration, que la drogue allait libérer les esprits et
sauver l'humanité ; la défonce n'était qu'une étape vers un monde
meilleur, plus humain, plus fraternel, plus cool.
En France (en Belgique, en ce qui me concerne), nous n'avions eu de cette
révolution qu'une image parcellaire, tronquée par les médias en mal de
frissons. Les hippies, avec leurs cheveux longs, leurs discours de doux
rêveurs, mais aussi leurs modes de vie qui effrayaient les
petits-bourgeois déjà méchamment secoués depuis quelques années par les
bouleversements successifs (les yé-yé, les blousons noirs, les coupes de
cheveux des Beatles, la mini-jupe), constituaient une matière en or pour
les journalistes. Je me souviens d'avoir vu, gamin, des reportages sur
Antoine-le-beatnik, avec ses Élucubrations. Des images de chevelus vêtus
de chemises à fleurs et de foulards multicolores, dansant sur des musiques
qui, à l'évidence, les mettaient en transe. Comme je grandissais dans une
famille d'artistes, je fus épargné : pas de discours du genre
qu'est-ce-que-c'est-que-cette-bande-de-dégénérés-il-leur-faudrait-une-bonne-guerre.
Même si je n'y comprenais rien, j'avais tout de suite trouvé les hippies
vachement sympas.
Plus tard, mon métier de journaliste et de rock-critic m'a amené à me
pencher sur cette période singulière. En tentant de m'y retrouver dans
cette invraisemblable explosion de créativité et de délire. En cherchant à
établir une chronologie cohérente. Et là, comme une évidence, je me suis
aperçu que tout se précipite à la rentrée 1966, comme un coup
d'accélérateur : musique, arts, culture, les événements se succèdent à une
vitesse frénétique jusqu'à l'automne 1967. Et là, telle une descente de
speed, tout retombe. Les enfants-fleurs de San Francisco défilent dans les
rues, annonçant la mort du mouvement hippie. Cinq mois après le lumineux «
Sgt. Pepper » des Beatles, les Rolling Stones – qui ont passé l'année à se
faire arrêter pour possession de drogue – publient le très sombre « Their
Satanic Majesties Request ». Entre l'automne 1966 et le début de l'hiver
1967/68, une année magique s'était écoulée. Le temps de souffler, la
jeunesse européenne prit le relais, en radicalisant son message, semblant
nous dire "puisqu'on n'y est pas arrivé avec des fleurs, essayons avec des
pavés". Ce sera la révolution de Mai 68. Le vent de liberté qui s'était
mis à souffler en 1967 se transforma en bourrasque. Mais je ne peux
m'empêcher d'éprouver une profonde affection pour mes grands frères
utopistes qui, à Londres et San Francisco, tentaient de changer le monde
en douceur. Bien sûr, quand j'étais punk, en 1977, je leur ai craché
dessus. Bien sûr, quand j'étais cynique, dans les années 1980, je me
foutais d'eux et de leur baba-coolerie. Mais c'est facile et lâche, de
taper sur des non-violents : on est sûr de ne jamais se prendre une baffe
en retour… Depuis quelques années, on sent bien que les idéaux hippies
refont surface : nos enfants, à leur tour, se les approprient. Parce
qu'ils donnent du monde une vision positive, fraternelle, où les relations
humaines priment sur toute autre valeur. Normal : ils étaient nés au
moment où l'on s'interrogeait déjà sur l'absurdité de la "société de
consommation", comme on disait. Ils reprennent de la vigueur depuis que le
néo-libéralisme et la mondialisation ont mis nos angoisses sur orbite. À
un détail près : si en 1967 il était encore possible de vivre en marge de
la société, aujourd'hui il est de notre devoir de saboter la World Company
et ses avatars…
Les hippies avaient raison. Ils avaient trouvé la clé d'un monde meilleur.
Celle-ci se cachait dans une chanson des Beatles, qui figure bien entendu
sur « Sgt. Pepper » : I've got to admit it's getting better / A little
better all the time…
Gilles Verlant
 - Nombre de pages : 96
- Format : broché avec rabats
- Illustrations : 100 photos couleurs
|